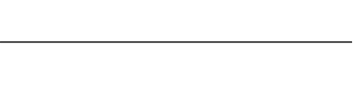
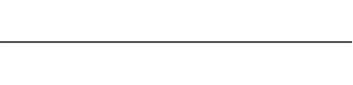
Sauveur Carlus
graphiste, illustrateur, peintre, auteur, compositeur, interprète
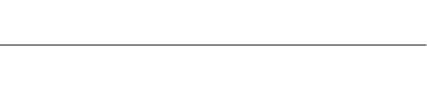
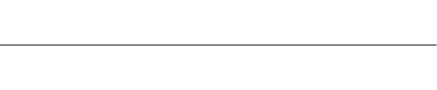
Étincelle
Six heures (am), le réveil m’arrache d’un rêve dont j’ai déjà oublié le contenu. Je cherche dans le noir le bouton pour faire taire la sonnerie, tâtonne autour de moi pour mettre la main sur mes pantoufles et sors de ma chambre à pas feutrés pour ne pas perturber le sommeil de Vinicio, mon colocataire italien. J’allume la cuisine. Dehors, la nuit garde encore prisonnières, dans ses griffes glaciales, les pauvres maisons victoriennes, grelottantes, collées les unes aux autres pour unir leurs forces et leur chaleur contre le froid accablant du matin. Ce spectacle m’afflige déjà et me coupe l’appétit. Je n’ai pas faim. Je ne bois qu’un verre de jus d’orange afin de me donner la sensation de réhydrater mon corps et de faire le plein de vitamines, et de me tranquilliser la conscience par rapport au fait de partir de si bonne heure le ventre vide. Je prends une douche rapide, me brosse les dents, plus pour rafraîchir mon haleine que pour ralentir l’action acide des aliments que je n’ai pas absorbés, m’habille et me coiffe à la hâte, et plonge dans l’océan laineux de mon manteau, de mon bonnet, de mon cache-nez et de mes gants afin d’être aisément paré pour affronter cette nouvelle nuit immonde qui s’achève et qui a décidé de retarder sa mort en traînant encore un temps dans les rues de Londres.
Il me faut marcher vingt minutes avant d’atteindre la station de métro. Vestige de la dernière averse, une large flaque – qui n’aura d’ailleurs pas le temps de s’évaporer puisqu’une autre averse trouvera un plaisir malsain à venir la regonfler – est traversée de plein fouet par un bus rouge à étage. Ce dernier éclabousse et inonde le trottoir. Je n’ai pas assez de temps pour me mettre suffisamment en retrait. Mes chaussures, mon pantalon et même le bas de mon manteau sont souillés.
À quoi bon résister de toute façon à cette humidité qui pénètre partout ? Le soleil n’est pas encore levé, mais il ne se lèvera aujourd’hui encore que pour jeter sur terre une lumière plâtrée. Les nuages, lourds, cimentent le ciel et se remettent déjà à cracher leur venin. L’eau n’en finit pas de couler. Et ce, depuis des jours. Les arbres vomissent, l’herbe se noie, les murs moisissent. Cependant, tous les autochtones qui m’entourent ont beau se saouler de ce déluge sans aucun espoir apparent d’accalmie, et d’éclaircie, mon âme veut y croire encore même si mon cœur, lui, continue de pleurer.
Mais à quoi pourraient bien servir quelques larmes ? Qui d’ailleurs les verrait au milieu de toute cette eau ? Voyons, je ne dois pas pleurer. Ce sont certainement la fatigue et la lassitude des matins routiniers… Pourquoi suis-je ici ? Ai-je eu raison de venir vivre dans ce pays ? À souffrir comme cela, pourquoi ne retournerais-je pas dans le mien, puisque j’y souffrirais sans doute de la même manière? À tant de souffrances, pourquoi s’en rajouter que l’on peut éviter ?
Mais déjà je m’engouffre dans la bouche du métro et me comprime entre une épaule et un coude. Mind the gap. La porte du wagon se referme violemment. Je fais partie d’un des tous premiers chargements de travailleurs. Certains bâillent et tentent de se caler le dos contre le dos des voisins pour finir leur nuit le plus confortablement possible, d’autres se grattent la tête en perdant leurs doigts dans des chevelures hirsutes, et moi, je ferme les yeux, pas pour dormir, mais pour tenter de m’abstraire, de m’élever, d’accoster sur une plage de poésie et de fouler une lande de rêve. Le métro n’est pas un ascenseur qui m’enfoncerait dans les entrailles d’une mine bourdonnante, il est loin aussi de ressembler à ces terribles convois qui ont mené tant de juifs, tant d’hommes et de femmes à la mort… Ces horribles visions me donnent soudain à considérer autrement ma situation. Une belle journée recommence. J’oublie ma tristesse passagère. Je suis à Londres et je travaille. J’ai l’ailleurs et la liberté pour moi tout seul.
Neuf heures moins le quart, nous sommes prêts, Alberto – mon manager – et moi-même, à ouvrir l’Espresso bar du Royal National Theatre. J’ai installé quelques tables sur la terrasse en prévision de clients assez fous pour se mesurer à la froidure atroce qui, malgré l’apparition certes tardive du soleil, a décidé de ne pas lâcher aussi facilement prise.
J’ai fait frire le bacon, grillé les toasts, préparé les sandwiches. Les donuts offrent maintenant leurs couleurs alléchantes, la machine à cafés ronfle chaleureusement, la Tamise, à quelques mètres à peine, suit son cours sempiternel vers une mer que je ne connais pas, mais dont on peut deviner déjà l’empreinte glacée sur les joues des premiers passants… et moi, bercé alors par le ronronnement de toutes ces visions et sensations devenues familières, je ne pense plus à rien, ni à ces gestes, ni à ces mots étrangers que je répète sans cesse et que j’ai appris comme une danse.
Le premier client arrive. Un habitué. Un régisseur, je crois, sur Singing in the rain. « Hello, how are you ? Cappuccino or caffè latte ? » Ah, mais oui… Où avais-je la tête ? Caffè latte… Monsieur prend toujours un caffè latte.
Ce n’est plus la peine que l’on me parle. Ce n’est même plus la peine que je dise quoi que ce soit. Je sais ce qu’il faut que je fasse. Tel ou tel bouton à presser pour soit moudre, soit serrer un café. Telle ou telle manette à actionner selon que je veuille apporter une certaine onctuosité à un cappuccino ou respecter toute la saveur d’un earl grey. Je suis le coffee maker, le faiseur de cafés, le spécialiste en la matière. Mon univers s’arrête aux limites de la machine. Elle et moi, nous ne faisons plus qu’un. Mes mains vont et viennent, les yeux fermés, d’un bouton à l’autre, d’un piston à l’autre. Tasse, mug, espresso, filtre, café américain, thé aux fruits des bois, tisane, infusion, chocolat chaud…, pour obtenir tels ou tels services, rien de plus simple : pliez mon pouce gauche, tirez sur mon oreille droite, appuyez sur mon menton… Mon anglais reste médiocre, mais derrière le comptoir, c’est moi, le maître. La machine respire, broie, lance des jets de vapeur, vit. Je gave de charbon l’estomac vorace d’une locomotive, je tiens fièrement la barre d’un transatlantique, je fais face à un tableau de bord gigantesque où une multitude de touches clignote dans tous les sens… Les clients affluent, je suis submergé de demandes, je me lance à corps perdu dans un tourbillon d’actions qui me donne un temps l’illusion de servir vraiment à quelque chose et d’avoir enfin trouvé ma place.
Midi trente, ma pause déjeuner. J’ai quarante cinq minutes pour me couper de ce ballet incessant, m’extirper de cette mascarade dévorante, reprendre des forces et redevenir moi-même. Alors, à la cafétéria du théâtre, seul dans mon coin, je scrute les visages des uns, essaie par tous les moyens de comprendre les conversations des autres. Tout reste flou. Et j’en suis d’autant plus frustré que je sais que tous ces gens ont, tout comme moi, au fond d’eux-mêmes, ce feu sacré de la scène. Des éclairagistes, des danseurs, des décorateurs, des tragédiens, des chanteurs, des dramaturges… Le Théâtre National de Londres, un vivier, une ruche grouillante, une place fameuse à travers le Monde. J’en ai poussé la petite porte et l’on m’y a accepté. Il ne s’agirait pas dès lors que j’en reste là. À moi de briser définitivement les barrières du langage et de m’assurer de solides contacts. Mais une heure quinze (pm) s’affiche déjà au fronton de Big Ben. Je ravale alors d’un trait toutes mes envolées lyriques et mes élans de gloire avec la dernière bouchée de mon yoghourt et cours reprendre du service.
Dix sept heures, je m’arrête un instant sur Waterloo Bridge. Le souffle de la mer pas si lointaine, venant de quelque contrée perdue derrière les hautes tours de Greenwich, là, en aval, et mêlé aux effluves indéfinissables du fleuve, fouette le visage en balayant sur nous tout ce qui pourrait traîner de sourire. Un pont tourmenté entre deux rives, un temps de paix entre deux actions, un repos mérité, octroyé, aménagé dans la tempête pour tenter tant bien que mal de nous laver l’esprit, détendre les nerfs et faire le vide.
Je regarde fuir la Tamise sous mes pieds. En moi accourent le pont Mirabeau, la Seine… Vienne la nuit, sonne l’heure, le souvenir d’un temps qui n’est plus. Le Temps, toujours ce joueur avide et féroce qui n’a que faire de nos amours, de nos passions, de nos regrets. Je me tourne vers l’amont. Le Parlement – et Big Ben encore, comme si l’emprise du temps n’était pas assez coriace – détache déjà ses ombres aiguisées sur un nouveau crépuscule. Je tente alors de fouiller derrière les pics de ses façades abruptes. Je gratte l’horizon. Je remonte au-delà. Paris, ma jeunesse, mon insouciance, et toi, Soria. Mais je ne vois rien, je ne ressens rien. A peine m’est-il encore possible d’entrapercevoir la moire d’une couleur, de humer la volupté fugace d’un parfum. Je vis à Londres depuis quelques mois. Cela pourrait bien faire une année. Je ne sais même plus tant ai-je l’impression d’avoir vieilli d’un coup. J’ai mille ans. Une rafale virevoltante me force alors à me retourner vers l’aval. Saint Paul’s Cathedral, Greenwich au fond, encore, et la mer… Aujourd’hui donc et tout ce qui m’attend demain ainsi que les autres jours. Jusqu’à la fin, le parcours semble décidé. Il n’y a aucune issue, aucune alternative. Des choix restent possibles mais demeurent bien à chaque fois un incident, un imprévu ou le fruit d’un hasard pour nous ramener sur ce chemin tracé pour nous, avant nous, par quelqu’un de plus fort que nous.
Dix huit heures, l’Aldwych Theatre, Covent Garden. Je pousse la porte vitrée du grand hall, dis bonjour en passant au box office man, soulève la corde de velours rouge et entreprends fièrement l’ascension du grand escalier qui mène directement au bar somptueux du dress circle. Je m’arrête un instant, pose ma main sur la rampe cirée, et sur laquelle glisse une cascade de reflets, et me retourne vers le bas. Dans le foyer, deux spectateurs viennent acheter des tickets pour la représentation de ce soir. Nos regards se croisent. Je devine dans le leur une foule de questions me concernant. Qui suis-je ? Que puis-je donc bien faire sur l’escalier, de l’autre côté de la corde ? Suis-je un membre du personnel ? Suis-je un acteur qui joue dans le show ? Oui, c’est ça… Je suis une star. Déjà je les vois me caresser d’envie, je sens leurs jambes frémir de s’approcher un peu plus de moi. Je suis un astre, je suis un rêve à portée de main. Regardez-moi bien car, à trois, je vais disparaître. Je lève un peu le menton, trempe mon visage dans les rivières du grand lustre, je prends la pose, oui, je l’avoue. Juste une seconde… Une… Laissez-moi savourer ce petit plaisir. Pardonnez-moi cet orgueil. Deux… C’est mon petit plaisir à moi, la petite cerise pour me récompenser de cette longue journée de travail qui est loin d’être terminée. Trois… Je m’en vais. Je reprends l’ascension de l’escalier. Encore juste ce dernier délice d’imaginer, dans mon dos, le regard éperdu des spectateurs, de lire dans leurs yeux aussi la douleur de voir filer une étoile. Je monte les marches de Cannes, je salue mon public, je lui envoie des baisers, j’arrive au dress circle bar. Et là, jouant aux cartes et fumant une cigarette, déjà deux ouvreurs, comme moi, attendent que l’on vienne ouvrir le vestiaire.
Chacun alors arrivera à tour de rôle. Ruth, une des plus anciennes ouvreuses et qui tient aujourd’hui le bar à champagne près du stalls, Tobie, le responsable réserve, et Gareth. Ils iront se joindre à la partie de cartes et, ensemble, feront éclater leurs voix. Manuela, ensuite, Catalina et Fredric, mes meilleurs amis, qui viendront s’asseoir à ma table, Rocio et Enrique, les head ushers, Valery, qui apportera les clefs du vestiaire, et quelques autres encore… L’équipe ainsi au complet, le théâtre pourra ouvrir ses portes, et il sera alors l’heure pour moi d’aller vendre mes programmes et mes bâtonnets de glace à la foule en délire.
Couverture
Extrait 3 : errance parisienne
Extrait 4 : horreur et magie londoniennes
Extrait 5 : tournage de Pimprenelle
Extrait 2 : course effrénée dans Paris
Extrait 1 : les charmes de l'âtre